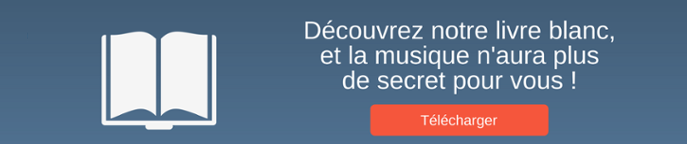Le monde de Ravel : biographie musicale d'un compositeur et orchestrateur de génie ...
Le vendredi 7 mars 2025, nous célébrions les 150 ans de naissance de Maurice Ravel. A cette occasion, nous vous proposons une biographie musicale de ce compositeur et orchestrateur de génie.
Enfance et formation
Maurice Ravel voit le jour le 7 mars 1875 à Ciboure, petite ville du pays basque français située près de Saint-Jean-de-Luz, d’où sa mère est originaire. La famille s’installe ensuite à Paris, où le jeune Maurice vit une enfance heureuse avec son frère cadet Edouard, dont il restera très proche toute sa vie. Les parents Ravel encouragent les dons musicaux de leur fils aîné : à l’âge de six ans, il débute le piano, et, dès 12 ans, il prend des cours de composition.
Quelques années plus tard, il intègre le Conservatoire de Paris en classe de piano, puis étudie la composition avec Gabriel Fauré. Ce dernier encourage Ravel à concourir au grand Prix de Rome, mais, au grand dam de son maitre, le prix lui sera refusé… cinq fois !
Pourtant, à la veille du XXe siècle, Ravel est déjà un compositeur reconnu : il a composé en 1899 sa célèbre Pavane pour une infante défunte, pour piano. Il en existe un enregistrement sur rouleaux par Ravel lui-même, disponible aujourd’hui au disque.
Le Cercle des Apaches
À partir de 1902, un groupe d'artistes, de poètes et de musiciens se regroupe autour de Ravel afin de partager découvertes et émotions artistiques. Le nom du Cercle viendrait d’un passant bousculé par l’un deux, et qui se serait exclamé "Attention, les Apaches", croyant avoir à faire à un gang de jeunes voyous qui sévissait à l’époque. Parmi les membres du groupe, on retrouve les compositeurs André Caplet, Albert Roussel, Florent Schmitt et le pianiste espagnol Ricardo Viñes, avec lequel Ravel s’était lié d’amitié au Conservatoire et qui sera l’un de ses interprètes attitrés. Les jeunes gens sont parfois rejoints par Manuel de Falla et Igor Stravinsky.
Les Apaches prennent la défense de Debussy lors de la création controversée de son opéra Pelléas et Mélisande, et, en 1912, c’est lors d’une de leurs réunions que Stravinsky donne la primeur du Sacre du Printemps au piano.
Ravel dédiera chacune des cinq pièces de Miroirs (1904-1906) à un membre des Apaches. Symbole de l'effervescence culturelle parisienne de la Belle époque, le cercle des Apaches se réunit régulièrement jusqu'en 1914, avant de disparaître avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale
Une époque heureuse et fructueuse
C’est durant cette période d’avant-guerre, qu’il décrira comme la plus heureuse de sa vie, que Ravel compose ses premiers chefs-d’œuvre, dans lesquels il affirme sa personnalité musicale : son unique Quatuor à cordes, des cycles de mélodies (Shéhérazade, Histoires naturelles), des pièces pour piano (Sonatine, Ma mère l’Oye, Gaspard de la nuit), son premier ouvrage lyrique (L’heure espagnole), et Daphnis et Chloé, une commande de Serge Diaghilev pour les Ballets russes.
On retrouve dans toutes ces œuvres les caractéristiques du style ravélien : goût pour les sonorités hispaniques et orientales, amour du fantastique et du merveilleux, raffinement mélodique et harmonique, précision rythmique, souci du détail et science de l’orchestration.
Le traumatisme de la guerre
Lorsque la guerre éclate, Ravel est plongé dans la composition de son Trio en la mineur qui deviendra l’un des grands trios à clavier du XXe siècle.
En mars 1915, alors qu’il était exempté en raison de sa faible constitution, il s’engage volontairement dans l’armée : il est envoyé près de Verdun comme conducteur de camion, puis d’ambulance. Pour le jeune dandy, raffiné, sensible, qui, jusque-là n’avait vécu que par et pour la musique, la violence de la guerre est un choc immense, qui aura sur lui un impact profond tant mentalement que physiquement. Atteint d’une dysenterie, il est réformé en mars 1917.
Cette même année, il compose Le Tombeau de Couperin, dont chacune des six pièces est dédiée à un ami tombé au front.
Durement marqué par l’expérience traumatisante de la guerre, à laquelle s’ajoute l’immense chagrin du décès de sa mère, Ravel s’enfonce alors dans une période de silence et de doute.
Sa première grande œuvre d’après-guerre est une nouvelle commande de Diaghilev. Allégorie de la grandeur, de la décadence et de la destruction de la civilisation occidentale broyée par le guerre, la Valse, que Ravel avait conçu comme ‘’un tourbillon fantastique et fatal’’ sera finalement refusée par Diaghilev, mais obtiendra un grand succès au concert.
Une célébrité à Montfort-l’Amaury
Après la mort de Claude Debussy, en 1918, Ravel est considéré comme le plus grand compositeur français vivant. Si les rapports entre les deux hommes ont toujours été distants, Ravel a toujours éprouvé une profonde estime pour son ainé : il lui dédie sa Sonate pour violon et violoncelle.
En 1921, Ravel, voulant s’éloigner de l’agitation de la capitale, achète une maison à Montfort-l'Amaury, petite ville située à 40 km à l’ouest de Paris, en bordure de la forêt de Rambouillet. Cette maison, qu’il appelle Le Belvédère, est aujourd’hui La Maison-Musée Maurice Ravel.
C’est dans ce havre de paix, aménagé à son image (jardin japonais, collections de porcelaines asiatiques, de jouets mécaniques, d’horloges) que Ravel vivra une vie paisible, entrecoupée de séjours au Pays basque et de tournées de concerts en France et à l'étranger. C’est là aussi qu’il composera la plus grande partie de ces dernières œuvres. Mais sa production musicale s’est considérablement ralentie : durant les douze dernières années de son activité créatrice, il ne composera en moyenne qu’une œuvre par an.
Mais quelles œuvres ! Citons Les Chansons madécasses, dont il dira que c’était l’œuvre dont il était le plus fier ; Tzigane, pour violon et orchestre, sous-titré ‘’morceau de virtuosité dans le goût d'une rhapsodie ; Boléro, devenu un succès planétaire jamais démenti ; L’Enfant et les sortilèges, fantaisie lyrique sur un livret de Colette, dans laquelle Ravel magnifie son goût pour la féerie et le monde de l’enfance ; les deux concertos pour piano ; et enfin Don Quichotte à Dulcinée, trois mélodies pour baryton et piano, sa dernière œuvre achevée, composée en 1932.
Un orchestrateur de génie
Le génie et l’imagination de Ravel se manifestent également dans son art de l’orchestration. Le Lever du jour de Daphnis et Chloé (1912) est souvent considéré comme le sommet de son art orchestral.
Le célébrissime Boléro, composé à la demande de la danseuse russe Ida Rubinstein en est un autre exemple. Basé sur un thème unique se déroulant sur un ostinato hypnotique, le Boléro, que Ravel considérait comme un simple exercice d’orchestration, fascine les auditeurs. Le critique musical Émile Vuillermoz parle de la "magie de la couleur" et des "vingt changements d'éclairage qui nous conduisent, émerveillés, d'un bout à l'autre de ce paradoxe musical". Et il ajoute qu’il n'y a pas, "dans toute l'histoire de la musique, un exemple d'une virtuosité pareille".
Ravel orchestre également certaines de ses pièces originalement écrites pour piano : la Pavane pour une infante défunte, Ma mère l’Oye, ou Le Tombeau de Couperin.
En 1922, à la demande du chef d'orchestre russo-américain Serge Koussevitzky, il réalise une extraordinaire orchestration des Tableaux d’une exposition, grande fresque pianistique composée 50 ans auparavant par Modeste Moussorgski. Encore une fois, Ravel se révèle comme le maitre du colorisme musical, et réussit le tour de force de conserver "l'esprit russe" de Moussorgski, tout en intégrante sa "pâte sonore" novatrice. Cette version orchestrale fait maintenant partie du grand répertoire symphonique, et est souvent présentée comme les "Tableaux d’une exposition de Moussorgski-Ravel".
La musique pour seule maîtresse
Ravel mena une vie privée discrète : on ne lui connait aucune liaison, ni féminine, ni masculine. Quand on lui demandait pourquoi il ne se mariait pas, il répondait : "J’ai une épouse depuis bien longtemps, c’est la musique".
Il menait cependant une vie sociale très riche : il se rendait souvent à Paris, au concert et au théâtre, et fréquentait les cafés et cabarets à la mode. Au Belvédère, il était entouré d’amis fidèles : les compositeurs Arthur Honegger, Jacques Ibert, Florent Schmitt et Germaine Tailleferre, les pianistes Marguerite Long, Robert Casadesus, Jacques Février et Vlado Perlemuter, la violoniste Hélène Jourdan-Morhange, et son fidèle élève, le compositeur et chef d’orchestre Manuel Rosenthal, qui apportera de nombreux témoignages précieux de la vie de son maître et ami.
Tournée américaine
En 1928, Maurice Ravel est au sommet de sa gloire.
Il entreprend alors une tournée de quatre mois aux États-Unis et au Canada, où il se produit comme pianiste, dirige des orchestres, donne des interviews et des conférences sur la musique contemporaine. Partout, il remporte un immense succès.
À New York, il rencontre le jeune George Gershwin, avec lequel il fréquente les clubs de jazz de Harlem. Ravel voyait dans le jazz une source d’inspiration, comme le montre le deuxième mouvement de sa Sonate pour violon et piano, intitulé Blues. Il trouvait que les Américains, prenaient "le jazz trop à la légère", et était convaincu "que c’est lui donnera(it) naissance à la musique nationale des États-Unis".
A son retour en France, Ravel compose le fameux Boléro, puis, simultanément, ses deux dernières œuvres majeures, deux concertos pour piano qui seront créés en janvier 1932 : le Concerto en sol et le Concerto pour la main gauche, écrit pour le pianiste Paul Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit au cours de la guerre. Le Concerto en sol sera ensuite jouée dans toute l’Europe lors d’une tournée triomphale, avec en soliste la pianiste Marguerite Long. Le mouvement lent reste l’une des pages les plus émouvantes de toute l’histoire de la musique.
Un douloureux silence
"La musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre, pourvu qu’elle charme et reste enfin et toujours la musique."
Ravel, 1828
Cette longue tournée, entreprise contre l’avis de ses médecins, laisse Ravel dans un état d’épuisement profond. Les signes d’une maladie cérébrale qui se révélera incurable, probablement aggravés par un accident d’automobile, se multiplient : problèmes de coordination, pertes de mémoire, troubles du langage. Bientôt, Ravel ne peut plus ni lire, ni écrire, ni jouer sa musique. Durant les quatre dernières années de sa vie, il se mure dans un silence douloureux, alors que son imagination reste intacte, ne trouvant de réconfort que dans ses promenades en forêt et dans la présence de ses amis proches et de sa fidèle gouvernante.
Après une opération chirurgicale de la dernière chance, Ravel sombre dans le coma et s’éteint 28 décembre 1937, à l’âge de soixante-deux ans.



 Cours de Musique à Charleroi
Cours de Musique à Charleroi